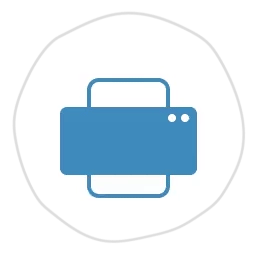La pandémie a réveillé l’Afrique et lui a rappelé la nécessité de repenser son agriculture et son économie, pour réduire sa dépendance aux importations et à l’insécurité qu’elle génère. Cette prise de conscience n’est que le début d’un long chemin vers une Afrique dynamique et autonome, longtemps divisée entre une agriculture ancestrale et des initiatives étrangères qui n’ont pas toujours légué un savoir-faire à la hauteur des besoins.
Jusqu’ici, l’Afrique a surpris par sa résilience face à la pandémie avec une population plus résistante au virus et une agriculture vivrière omniprésente qui amortit la situation, comparativement aux pays industrialisés.
Si des restrictions sanitaires sont instaurées pour lutter contre la pandémie, les filières nationales de production et d’acheminement réussissent à se maintenir, notamment pour fournir les principales agglomérations africaines.
L’agriculture africaine locale vue comme une agriculture artisanale, renfermée sur elle-même et peu optimisée, a, pour ces mêmes raisons, bien résisté aux fermetures des frontières et à la chute des échanges.
Résistance à la flambée des prix denrées
L’agriculture vivrière a bien joué son rôle en Afrique de l’Ouest où les petites mains agricoles sont restées disponibles pour produire le sorgho, l’igname et le manioc, remarque Patrick Dugué, agronome au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD).
Cette crise est le révélateur de l’importance de ce secteur d’activité dans la sécurité alimentaire des pays africains.
En réponse à la valse des étiquettes concernant certaines denrées, des pays comme la Côte d’Ivoire ont fait le choix de les subventionner ou de plafonner leurs prix pour préserver les populations et maintenir l’équilibre politique et social.
Mais l’Afrique souffre tout de même de la défaillance des autres continents vers lesquels elle exporte et de la fermeture des marchés locaux où les petits producteurs peuvent écouler leurs marchandises. C’est la première fois, depuis les années 90, qu’elle connaît une récession.
En Guinée par exemple, des producteurs de pommes de terre n’ont pu écouler leur production faute de marchés en plein air, ni recevoir leurs semences en provenance du Sénégal.
Ces situations privent les producteurs de revenus, y compris ceux qui écoulent habituellement leurs denrées auprès des circuits de distribution urbains. En effet, les citadins ont vu, eux-aussi, leur pouvoir d’achat chuter en raison de la pandémie et du ralentissement global d’activité qu’elle a engendré.
Sur un continent où 20% de la population sont déjà concernés par la faim, on peut craindre une progression de l’insécurité alimentaire.
Aléas climatiques et conflits
Outre la pandémie, l’Afrique est aussi victime d’épisodes climatiques extrêmes, par inondation ou sécheresse :
- Inondations exceptionnelles au Sénégal ou en Ethiopie ;
- Invasions destructives de criquets pèlerins en Namibie.
A cela, viennent s’ajouter les conflits qui sévissent en différents endroits du continent et qui déplacent des populations habituées à se nourrir par la culture sur leur propre lieu de vie, ce qui devient impossible en itinérance ou dans des camps de réfugiés.
Alexandre Le Cuziat, responsable de la division urgence au Programme alimentaire mondial (PAM) indique qu’un million de Burkinabé ont dû fuir des violences et abandonner les récoltes et que 13 millions d’individus ont dû bénéficier de l’aide du PAM, soit 30% de plus qu’habituellement.
Dans les pays particulièrement fragiles et touchés par la famine, le PAM demande une mobilisation internationale mais insiste sur la nécessité d’appuyer la construction d’un système local autonome capable de lutter contre les crises alimentaires.
La lutte contre la faim ne peut pas se résumer aux distributions alimentaires faites en urgence (60% des aides), notamment parce que les circuits de distribution sont rapidement fragilisés, comme c’est le cas en cas de restrictions sanitaires ou de conflits.
Cette lutte contre la faim doit développer son volet préventif en facilitant les échanges monétaires, en instaurant des amortisseurs sociaux et en appuyant une agriculture plus résiliente.
Quelle est la situation des pays d’Afrique aujourd’hui, face aux défis permanents ou ponctuels qu’ils doivent affronter ? Petit tour d’Afrique, entre crises et initiatives qui bouleversent la qualité de vie des populations, en bien ou en mal.
Au Soudan, la cacahuète vaut de l’or
Cinquième producteur mondial de cacahuètes selon les Nations unies, le Soudan cultive un million et demi de tonnes d’arachide par an, avec une part exportée qui représente un peu plus de 200 millions de dollars (Banque centrale soudanaise).
Ici, l’oléagineux n’a pas d’âge, au point que cacahuète se dit « sudani » en arabe.
Une usine de production d’une pâte ultra riche, appelée Plumpy’Nut, retient toute l’attention. Invention de deux scientifiques français, c’est une pâte à forte valeur nutritionnelle, destinée aux enfants victimes de malnutrition. La Food and Agriculture Organization (FAO) considère ce produit comme un aliment thérapeutique prêt-à-l’emploi (ATPE), aussi appelé ready-to-use therapeutic food (RUTF).
Les paysans y voient l’opportunité de vivre de cette production oléagineuse et d’améliorer le niveau de vie local, même s’ils subissent cette année une forte inflation qui grève leur pouvoir d’achat. Leur motivation à sauver des vies trouve une limite dans leur capacité à sauver la leur.
Mais le Soudan a une grosse capacité agricole et ce type de produit, innovant tant dans la formule que dans la cible, stimule les esprits entreprenants qui cherchent d’autres matières premières à valoriser.
A l’origine, ce sont 2000 producteurs, organisés en coopérative, qui répondent à une entreprise soudanaise décidée à développer le concept français au Soudan. Avant l’arrivée de cette usine, les producteurs éprouvaient des difficultés à écouler leur production dont une partie périssait régulièrement. Mais cette nouvelle filière implique une matière première de qualité, obligeant les producteurs à améliorer leur processus de production et à s’équiper.
L’entreprise, Samil Industrial Company, accompagne les producteurs à l’obtention de prêts pour transformer leur activité en production durable. Aujourd’hui, dans l’usine de Khartoum, la capitale, des tonnes de cacahuètes sont mixées avec de l’huile, du sucre, de la poudre de lait et des vitamines pour produire ces barres nutritives. Une deuxième usine a ouvert au Darfour.
Ce projet répond finalement à un territoire qui a la capacité de produire la matière première et dont la population est directement concernée par la malnutrition. Entre les deux, c’est une opportunité de valoriser le travail des populations locales et de construire une économie durable.
Les Plumpy’Nut sont vendus aux organisations internationales avec une production de 14.000 m3 par an pour 2 millions d’enfants concernés en 2020.
Au Burkina Faso, l’argent ne peut pas tout
La crise humanitaire au Burkina Faso est d’une fulgurance inédite, entre Covid 19, menaces extrémistes et excès climatiques, un Burkinabè sur dix souffre de la faim.
A l’instar de Kalidiata Badini, 63 ans, qui a dû quitter le Nord du Burkina Faso et abandonner ses champs et ses animaux. Elle se retrouve à extraire du sable au tamis durant des jours, pour un maigre revenu, un peu plus de 4 euros, obtenu par la vente de ce sable à un fabricant de parpaing. Veuve, avec 7 enfants, elle s’est réfugiée dans la banlieue de Ouagadougou, dans une maison sans eau ni électricité.
De sa ferme nourricière, qui assurait son alimentation et son revenu, il ne reste rien, les attaques incessantes de groupes extrémistes l’ont forcée à fuir vers une banlieue qui ne permet pas une activité agricole et qui réduit ses enfants à mendier dans la rue.
La ville refuse d’installer une zone d’accueil spécifique et incite les familles à se rendre dans des camps situés au Nord où l’insécurité règne encore et où les évènements climatiques et restrictions dues au Covid 19 ont scellé le sort des agriculteurs. Un drame pour une population qui dépend à 80% de l’agriculture.
Dans les zones à risque, la lutte contre la faim ne peut pas prendre la forme d’une distribution alimentaire. Dans les provinces du Soum et de l’Oudalan, l’état d’urgence alimentaire est déclaré. Pour répondre, le gouvernement burkinabé a multiplié par trois le budget de son Plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables, l’élevant à 120 millions d’euros.
Concrètement ce budget d’aide alimentaire n’a pas de réalité dans le quotidien de Kalidiata Badini. Ses enfants ont abandonné leurs projets professionnels pour assumer une responsabilité familiale bien lourde. Une régression pour la famille Badini mais aussi pour le pays qui voit le potentiel burkinabè gâché et sans doute un vivier de main d’œuvre qualifiée qui fera défaut à moyen terme.
Nigeria, une ambition sans moyens
L’actuelle flambée des prix fait passer le riz, aliment de base, pour un produit de luxe.
L’autosuffisance en riz reste une ambition vaine pour le Nigeria dont la production locale est insuffisante. Dans ce pays le plus peuplé d’Afrique, le riz est rare.
Le président Muhammadu Buhari lui-même a rappelé qu’il voyait dans l’agriculture un outil de lutte contre la faim et la pauvreté et le moyen d’accéder à l’autosuffisance. Le pays avait d’ailleurs fermé ses frontières à l’importation, dès l’été 2019, dans l’espoir de stimuler la production locale.
L’initiative protectionniste couplée aux restrictions de circulation imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus ont réduit la disponibilité des denrées importées ou produites.
Les prix alimentaires ont réagi à la hausse dans un pays entré en récession, tous les ingrédients d’une déstabilisation économique et sociale.
Depuis, le Nigeria a revu sa position et autorisé, en décembre dernier, la reprise d’importations, à l’exception du riz pour lequel le gouvernement compte sur une production nigériane.
Cette politique a rapidement porté ses fruits et facilité l’écoulement des productions locales mais elle s’avère insuffisante pour nourrir le pays. D’abord, parce que ces agriculteurs à qui on demande de nourrir 200 millions de personnes, sont sous-équipés et non formés à optimiser leur exploitation. Jusqu’à présent ils assuraient une culture en partie réservée à leur propre subsistance.
Dans le district de Guma, Henry Vaa, agent local, forme les agriculteurs, soutenu par le Fonds international de développement agricole de la multinationale singapourienne Olam. Ce fonds finance une partie des intrants achetés par les agriculteurs organisés en coopérative puis rachète leur riz à un prix fixe.
Au-delà, il est difficile pour les agriculteurs d’emprunter des fonds pour s’émanciper techniquement et économiquement. Adedayo Bakare, économiste à MoneyAfrica, une plateforme d’« alphabétisation financière », rappelle que l’agriculture ne réalise que 7% des prêts pour un secteur qui pèse 22% du PIB, alors que le secteur pétrolier réalise 30% de ces prêts pour 9% du PIB. Un accès déséquilibré aux financements, même pour s’assurer contre les aléas climatiques qui ont emporté 90% des productions dans la région de Kebbi en octobre dernier.
Certains agriculteurs s’indignent et considèrent qu’il ne suffit pas de décréter qu’une agriculture a du potentiel. Il faut accompagner les agriculteurs à l’expression de ce potentiel.
Aujourd’hui, les populations s’opposent pour des terres et les matériels restent une denrée rare. La compétition pour des surfaces arables a tué des milliers de personnes, elle provoque des déplacements de populations qui s’opposent en raison de leur religion et de cette course à la terre.
L’agriculture nationale nourricière reste un projet fragile, entre le manque de formation, le sous-équipement, l’accès restreint aux financements, la menace terroriste dans certaines régions et les aléas climatiques.
Selon la FAO, près de 10 millions de personnes sont déjà en situation alimentaire déficitaire au Nigeria. Cette condition pourrait même toucher la Middle-Belt, une zone verdoyante habituellement propice à la culture.
Cameroun : éducation nutritionnelle
Selon le rapport SMART 2019, une méthodologie d’analyse de situation nutritionnelle, les enfants camerounais en bas âge est précaire dans certaines provinces du pays.
Attaques terroristes, inondations, sécheresses…. Résultat, plus d’un tiers des enfants sont malnutris et un sur cinq est en insuffisance pondérale. Aviba Dadi, 2 ans et demi, a le corps d’une enfant de quelques mois et ne marche pas. Sa jeune mère, âgée de 18 ans, la nourrit de Plumpy’Nut, des sachets d’aliments enrichis distribués dans son centre de santé. La petite fille doit en consommer 20 par jour pour maintenir sa situation pondérale.
Thomas Lapobé, responsable des activités de prévention contre la malnutrition à la délégation régionale de la santé de la région Nord, avoue que la multiplication des aides en provenance d’organisations internationales ne fait que masquer un « problème endogène et local ».
33% de la population est en situation d’insécurité alimentaire dans cette région selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Les évènements climatiques empêchent les femmes de cultiver les aliments nécessaires à leur famille. Des familles qui passent parfois plusieurs jours sans manger ou qui utilisent une eau polluée pour la préparation des repas.
La sous-nutrition des enfants est aussi le fruit d’une culture, celle qui impose de réserver les aliments les plus intéressants aux anciens, alors qu’ils seraient utiles à la croissance des jeunes organismes.
Pour lutter contre ce fléau, la Cameroun mise sur un programme « l’alimentation cinq étoiles », une communication simplifiée qui vise à informer les mères des nutriments essentiels à la croissance de leur enfant : vitamines, lipides, glucides, protéines et sels minéraux. Le programme d’enseignement consiste à indiquer les aliments qui comblent les besoins pour chaque nutriment : des céréales et tubercules pour les glucides, des légumineuses pour les protéines…
« Nous leur expliquons les cinq familles de nutriments auxquelles est attribuée une étoile et les aliments qui leur correspondent », explique M. Lapobé. L’étoile des glucides avec les céréales ou les tubercules comme le mil rouge, le maïs, le manioc, le blé, les ignames ; l’étoile des protéines issues de la viande, du poisson ou des légumineuses comme les arachides, le soja, le sésame, etc.
Cette compréhension est essentielle, le Plumpy’Nut reste un aliment de secours. Distribué gratuitement, il est même l’objet de convoitise, entre les hommes qui le considèrent comme un aphrodisiaque ou d’autres qui le revendent au marché local.
Certaines ONG ont même fait le choix de la distribution de coupons alimentaires afin que les mères se procurent les ingrédients localement, c’est le cas de l’ONG Helen Keller International qui se félicite d’un taux de réussite de 95% là où elle met en place ce système
Sud Soudan : des exodes définitifs ?
L’État du Jonglei a subi d’importantes inondations et connu des conflits, laissant place à une zone d’insécurité alimentaire selon les Nations Unies. Des milliers de personnes ont fui et se retrouvent dépourvus de moyens de subsistance.
Dans ce pays, plus de 6 millions de personnes, représentant la moitié de la population, sont en situation grave sur le plan alimentaire. Entre insécurité, Covid 19 et inondations, 2021 pourrait voir leur situation s’aggraver.
Les conflits persistants et le risque encouru par les intervenants humanitaires laissent la population de déplacés aux abois. La plupart ont tout perdu dans les inondations. 500.000 ruminants auraient été décimés suite à la montée des eaux, selon l’ONU.
Malgré la résilience de cette population, habituée à affronter seule les obstacles du quotidien, elle se sent démunie, sans bétail ou terres à cultiver.
Avec la levée des restrictions de circulation, les équipes de la FAO sont venues établir un constat des besoins, notamment pour le bétail survivant et tester des compléments alimentaires pour celui-ci. Des bergers venus signaler leurs besoins constatent avec soulagement que leur bétail accepte cette alimentation de substitution
Ceux qui sont arrivés après avoir perdu leur bétail sont plus en difficulté. Ils ont faim, n’ont pas accès aux soins et se sentent en insécurité. Ils sont impatients de retourner sur leurs terres d’origine même si l’opportunité de ce retour est très incertaine. Les plus avertis savent que l’exode urbain n’est pas pour eux et que la ville de Juba, réservée aux riches, ne leur offrira qu’une vie de misère.
Une résilience insuffisante
A l’issue de cette revue des expériences africaines, il est confirmé que la population de ce continent est capable d’une résilience indiscutable. Mais elle ne suffit pas. Parfois, elle relève plus d’une acceptation, au-delà de l’entendement, d’une vie qui n’offre plus le minimum vital.
Les obstacles à une vie confortable peuvent être ponctuels comme les accidents climatiques ou la pandémie mais ils sont aussi structurels et économiques, dans des pays où les politiques publiques doivent accompagner les populations à l’amélioration de leur propre condition par l’éducation, la formation et le financement des projets de développement.
Source : Le Monde