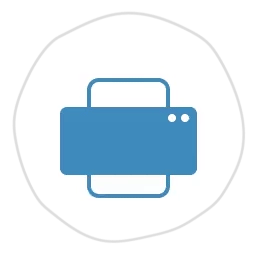L’urgence écologique se concentre sur le changement climatique. C’est légitime mais cela conduit à une obsession simplificatrice : l’énergie est rare, il faut donc l’économiser. En France, on n’économise pas les lois et la formule « L’énergie est notre avenir, économisons- la » est une mention légale que doit afficher toute entreprise du secteur énergétique.
Mais quand on replace la question de l’énergie dans une perspective élargie, on découvre rapidement une évidence : l’énergie reçue par notre planète est en excès. Ce qui est rare, c’est l’espace, l’espace terrestre, et notamment l’espace nécessaire pour exploiter cette énergie en excès.
La transition énergétique fait émerger cette rareté de l’espace et la renforce. L’agriculture est concernée directement par l’énergie qu’elle consomme intensément et par l’énergie qu’elle peut produire (biocarburants). Mais elle l’est aussi indirectement par la concurrence spatiale.
L’espace est rare, particulièrement pour l’énergie et l’agriculture : c’est lui qu’il faut économiser.
- Excès d’énergie ? À cause du soleil…
La totalité de la biomasse et presque toutes les énergies sont d’origine solaire. Parmi elles, deux familles :
- énergies issues d’un stock, donc non renouvelables (charbon, gaz, pétrole)
- énergies de flux, renouvelables : directement (photovoltaïque) ou indirectement produites par le soleil (hydraulique, éolien, biocarburants)
L’utilisation du charbon à la fin du 18ème siècle a donné une impression d’abondance, elle a engendré la croissance presque explosive de la production matérielle et de la démographie, en Angleterre puis en Europe. Les énergies fossiles par leur facilité d’utilisation ont provoqué une rupture, la naissance de ce qu’on appelle l’anthropocène[2] : l’espèce humaine est devenue invasive et dyschronique (elle impose son rythme d’évolution au reste du vivant).
Les énergies renouvelables d’origine solaire, quant à elles, ne sont pas rares. Au contraire, elles sont (théoriquement) disponibles en excès. La terre reçoit en un an, en retranchant ce que son atmosphère réfléchit du rayonnement solaire, 1000 milliards de gigawatts-heures. Cela représente plus de 10 000 fois l’énergie consommée par les hommes.
C’est la vision grandiose de Georges Bataille ( La part maudite, 1949). La vision systémique de l’excès. Elle a été ignorée ou mise de côté, à tort. Elle débouche sur l’idée qui semble paradoxale qu’il faut non pas « économiser » mais dépenser, consumer, dilapider l’excès. Pour éviter la croissance, la sur-croissance mortelle. L’effet de serre, lui-même, est une confirmation de la vision de Bataille (une confirmation qu’il n’avait nullement envisagée): car l’effet de serre résulte de deux excès, celui du soleil d’une part et celui de la « prolifération gazeuse de nos activités industrielles, de nos moteurs » d’autre part. Je reviendrai sur la question de la croissance, non pour soutenir l’idée simpliste de décroissance mais sur l’urgence de mettre en œuvre une autre croissance, une nouvelle forme de développement, un développement respectueux de l’environnement, centré sur la croissance des secteurs de la santé au sens large, de l’éducation et de la formation, de la recherche et de la culture. Réduisant le temps et la pénibilité du travail mais pas l’emploi.
Il existe une troisième famille d’énergies, celles qui ne viennent pas du soleil.
La géothermie profonde : 99% de notre terre dépasse les 1000° Celsius, en très grande partie à cause de la radioactivité naturelle et c’est une énergie pratiquement inépuisable.
L’énergie marémotrice qui est presque totalement liée à la lune.
Enfin l’énergie atomique : dans sa forme actuelle ce n’est pas une énergie renouvelable mais les nouvelles technologies nucléaires (small modular reactors, en particulier les réacteurs à sels fondus et thorium) se rapprochent des énergies renouvelables (avec une meilleure gestion, voire une réutilisation de certains déchets) mais ne seront pas disponibles avant une décennie, au moins. Il ne faut pas oublier enfin, à beaucoup plus long terme, l’énergie nucléaire liée à la fusion (produire de l’énergie « comme le soleil », mais sur terre).
Le déploiement du nucléaire pourrait changer radicalement la donne énergétique mais après 2050 seulement, sans doute trop tard pour éviter le désastre climatique, si rien n’est entrepris tout de suite.
Le seul espoir pour éviter ce désastre repose donc sur les énergies renouvelables. Grâce à elles, et grâce aux énergies nucléaires à partir de 2050, on peut espérer disposer d’une nouvelle abondance d’énergie propre.
- Une demande d’énergie fortement croissante
Cela tombe bien car la demande d’énergie dans les trois prochaines décennies sera très forte. Pour des raisons démographiques tout d’abord : nous sommes actuellement 7,5 milliards et il y aura plus de deux milliards de personnes supplémentaires sur terre d’ici à 2050. En outre, la plupart d’entre eux habiteront en Inde et en Afrique, dans des pays ayant des besoins énergétiques immenses ; il faudra les nourrir (sous d’autres régimes alimentaires) et l’on sait que l’agriculture exige beaucoup d’énergie, mais aussi les loger, satisfaire des besoins élémentaires d’hygiène et de santé…
Après 2050 ? La progression démographique se ralentit, s’arrête puis s’inverse. Ensuite, l’énergie nucléaire prend le relais et les énergies renouvelables propres sont arrivées à maturité. Reste toutefois le problème du méthane, mais ce défi, l’agriculture pourra probablement y répondre.. Mais cela ne règle pas tout et encore faut-il arriver jusque-là.
Les trente prochaines années sont donc cruciales.
Il faut réduire le plus possible et le plus vite possible le recours aux énergies fossiles, pour des raisons nombreuses et évidentes, mais principalement pour réduire les émissions de GES.
D’où l’idée d’économiser l’énergie évoquée en introduction. Ces économies sont nécessaires mais insuffisantes. Celles réalisées dans les pays développés (le G7) donnent bonne conscience mais auront un impact faible sur le changement climatique, certaines (par exemple, l’isolation des bâtiments et logements anciens ) sont même de fausses bonnes idées. Les seules économies vraiment intéressantes sont les innovations que l’on peut transférer ou exporter mondialement.
C’est dans cette perspective d’économie qu’est apparue la notion d’empreinte carbone. L’Union européenne vise la neutralité carbone en 2050. Elle l’atteindra sans doute mais, compte tenu de son poids démographique, cela ne changera pas la donne mondiale. Les outils de la finance verte et les normes RSE ( sans doute serait-il bon, compte tenu de l’urgence, de placer l’environnement avant le social) vont jouer un rôle utile. Mais c’est d’abord la mise en place, à un niveau adéquat, d’une taxation carbone, si possible au niveau mondial qui peut jouer un rôle décisif (cf. les travaux de Jean Tirole, Prix Nobel d’économie, sur le marché des droits à polluer).
Ces outils financiers et fiscaux sont au service de la stratégie principale fondée sur le déploiement des énergies renouvelables implantées sur tous les territoires disponibles.
- Rareté de l’espace
Chaque territoire, quelle que soit l’échelle géographique considérée (régional, national, mondial) doit donc découvrir son « génie énergétique » et le développer au mieux. À cet égard les pays et les régions sont très divers : Islande, Gabon, Mauritanie, Californie, Maroc, France n’ont pas du tout les mêmes spectres d’énergies renouvelables.
L’utilisation de l’hydrogène comme combustible (moteurs de fusées et d’avions) mais surtout comme vecteur énergétique, notamment pour toutes les formes de mobilité, offre à ces énergies renouvelables un très large éventail de potentialités nouvelles.
Mais la nuisance zéro n’existe pas : comment éviter le syndrome NIMBY ? À ce niveau les travaux d’Elinor Ostrom (prix Nobel d’économie 2009) sur les communs et la gouvernance « polycentrique », complètent l’approche par les marchés des droits à polluer.
De façon beaucoup plus générale, l’espace permettant de capter l’énergie solaire de façon directe (panneaux solaires) ou indirecte ( éoliennes de toutes sortes, utilisation de la biomasse) est de plus en plus convoité. Les grands opérateurs de l’énergie ne recherchent plus seulement de nouveaux gisements de combustibles carbonés, ils cherchent des espaces adéquats pour exploiter les énergies renouvelables, de façon optimale et sans provoquer trop de nuisances.
C’est donc l’espace, plus que l’énergie, qui devient rare : rare pour les implantations d’éoliennes ou de panneaux solaires, mais aussi et plus généralement pour conserver les terres arables et les espaces naturels favorables à la biodiversité.
En effet, tous les espaces industrialisés (« la prolifération osseuse des usines » écrivait Bataille) et ceux liés à la consommation, l’habitat, la mobilité menacent cette biodiversité.
À côté de l’empreinte carbone, qui engendre souvent des calculs quelque peu obsessionnels et des engagements sans grand intérêt, même s’ils sont tenus, il faut donc introduire l’empreinte spatiale.
- L’empreinte spatiale
Ce terme d’« empreinte spatiale » a déjà été utilisé, mais pour des calculs locaux. Par exemple, comme indicateur de la surface allouée aux transports urbains : réseau routier, parkings, infrastructures de transport en commun, etc. À cette empreinte spatiale directe on peut ajouter l’espace nécessaire à l’absorption des émissions de CO2 provoquées par le transport. Il est aussi utilisé pour évaluer les approvisionnement agro-alimentaires locaux ou encore l’impact au sol des équipements miniers, etc.
Cette notion doit être élargie à toutes les formes de bétonisation et d’artificialisation des sols qui ont résulté de la révolution industrielle, révolution permise par la disponibilité des énergies fossiles (le charbon à l’origine). Georges Bataille parle à cet égard de la « prolifération osseuse des usines ». Mais ce ne sont pas seulement les usines qui occupent l’espace, ce sont les villes, les logements et les commerces, les routes et autres infrastructures de transport.
Une évaluation récente (Nature, décembre 2020) montre l’amplitude du problème : les humains ne représentent que 0,01% de la biomasse totale de notre planète, c’est-à-dire de l’ensemble du vivant (plantes, animaux, champignons, micro-organismes). Mais cette minuscule part du vivant a produit aujourd’hui une masse de matière inerte, que l’on appelle l’anthropomasse, de 1154 gigatonnes (une Gt = 109 tonnes) de béton (549 Gt), d’agrégats (386 Gt), de briques (92 Gt), d’asphalte (65Gt), de métaux, de verre et de plastique. Cette masse est devenue supérieure à celle, 1120 Gt, de la biomasse totale.
Au début du XXe siècle, cette masse inerte ne représentait que 3% de la biomasse. Si l’évolution se poursuit au même rythme, elle pourrait représenter trois fois la biomasse d’ici à 2040. Il est difficile de croire qu’une seule espèce, qui ne représente que 0,01% du vivant, transforme les ressources spatiales de la planète à ce rythme.
On comprend ainsi que la biodiversité n’est pas menacée seulement par le changement climatique mais aussi par cette masse croissante et, plus précisément, par son emprise au sol (une tour urbaine consomme moins d’espace utile qu’un tronçon d’autoroute). Il en est de même pour les terres arables : 0, 19 hectare/habitant en 2016 contre 0, 49 hectare/habitant en 1945 (Le Déméter 2021)[4].
Le terme d’anthropocène (encore discuté par la communauté scientifique des géologues) s’est répandu à partir de la menace climatique mais « l’ère de l’humain » débute avec la révolution industrielle et se confirme au milieu du 20ème siècle : les humains deviennent une « force géologique » modifiant, perturbant, menaçant la biosphère. La formulation me semble quelque peu excessive, présentant l’espèce humaine « comme » une force géologique. Ce n’est pas la planète qui est menacée mais la biosphère, ce qui est déjà beaucoup ! Le slogan ressassé, « Sauver la planète », qui vient directement de l’angoisse climatique, doit plutôt laisser la place à celui plus modeste mais plus mesuré de « Sauver la terre ». Sauver le terrain – terrestre et maritime – le sol arable, cette ressource si rare, pour éviter l’effondrement de la biodiversité et de la production agricole.
- La guerre de l’espace
L’emprise au sol est encore accentuée par la transition énergétique des prochaines années puisque les énergies renouvelables « consomment » beaucoup d’espace. Il faut donc évaluer cette nouvelle emprise au sol et rechercher les solutions optimales. Pour une même quantité d’énergie (un térawattheure) il faut 89 400 hectares pour produire du biodiesel à partir de soja, 34 710 hectares pour obtenir de l’éthanol à partir de maïs. L’emprise au sol de l’éolien terrestre est évaluée à 7 200 hectares, celle du photovoltaïque (qui ne cesse de progresser techniquement) à 3700 hectares. Et celle du nucléaire à 49 hectares…
Mais la guerre de l’espace déborde complètement la transition énergétique. Rompre le lien entre consommation d’énergie fossile et croissance mondiale est possible à terme, mais la croissance matérielle continue à recouvrir la monde. Retrouver l’abondance énergétique qui a permis l’expansion industrielle pourrait même aggraver la situation en permettant la poursuite d’une expansion matérielle largement libérée des contraintes climatiques : une transition énergétique réussie vers une énergie abondante et dé-carbonée, est à la fois souhaitable et périlleuse. Car la poursuite mondiale de la croissance, dans les formes que nous connaissons aujourd’hui, est impossible.
Face à une énergie redevenue abondante, il faudra donc redoubler d’efforts pour infléchir la croissance matérielle vers un développement respectueux de l’environnement. Pour ne pas en rester aux généralités, je prendrai l’exemple de la mobilité : la croissance de toutes les formes de mobilité (automobiles, trains, avions…) est étroitement liée à la croissance matérielle (elle contribue pour environ un tiers aux émissions de GES aujourd’hui). On peut faire baisser ces émissions (notamment grâce à la généralisation de l’utilisation de l’hydrogène). Mais ce qu’il faut éviter c’est l’extension du réseau routier et autoroutier. Si la Chine, l’Inde, l’Afrique réalisaient des équipements routiers comparables à ceux de l’Europe et des États-Unis, ce serait une catastrophe.
Il semble d’ailleurs, heureusement, que ce soit impossible à cause d’une rareté, celle du sable marin (ou fluvial), indispensable pour la fabrication du béton. Il faut 30 000 tonnes de sable pour faire un kilomètre de route, 12 millions de tonnes de sable pour une centrale nucléaire. Deux-tiers des constructions sur la planète sont constituées de béton et deux-tiers de ce béton est constitué de sable. La Chine durant ces dernières années a consommé autant de sable que les États-Unis en un siècle. Dès aujourd’hui une « guerre du sable » fait rage dans le monde et n’est pas prise suffisamment au sérieux.
La mobilité du 21ème siècle devra donc s’orienter vers une sobriété spatiale et, par exemple, favoriser le transport aérien (drones, avions à hydrogène) plutôt que l’extension des infrastructures routières. Ou encore, reconnaître l’intérêt des concentrations urbaines dont l’emprise au sol, y compris en termes de mobilité, est relativement faible (surtout si ces concentrations urbaines ne détruisent pas des terres arables).
Toutes ces transformations vont exiger deux piliers. L’un d’ordre scientifique et technologique, l’autre d’ordre symbolique.
Au niveau scientifique et technologique, l’apport des pays riches ou en transition avancée est essentiel. Faire des économies, rechercher obsessionnellement la neutralité carbone n’est pas inutile mais n’est pas à la hauteur des enjeux. Sauf si on sait les adapter et les exporter vers le reste du monde. Le levier principal reste l’innovation. Dans le domaine de l’énergie qui irrigue tout le système économique, mais aussi au-delà (agriculture, logement, transport). Une réorientation en faveur de la finance verte est un levier à privilégier et il serait même légitime que, dans certains cas, les droits actuels de propriété intellectuelle soient réduits pour mieux faire circuler l’innovation, notamment en faveur de l’Afrique dont les besoins d’énergie seront immenses dans les prochaines années.
Au niveau symbolique, il faut sortir d’une perception quasi religieuse des enjeux de l’écologie ; cesser d’opposer ordre économique et ordre écologique, articuler les deux en soumettant le premier au second. Plus largement encore, articuler la compétition (qui fonde l’ordre économique de l’Europe puis de l’Occident, puis du monde), avec la coopération, la solidarité, l’adéquation du développement à un monde fini, la promotion des biens communs. Promouvoir un développement des secteurs de la vie (santé, éducation, recherche, culture) pour limiter les croissances matérielles qui, par leur empreinte spatiale, menacent la biodiversité et réduisent nos ressources non renouvelables.
Rien de moins finalement, que d’associer au projet de Descartes (« nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ») fondé sur le pouvoir, la recherche de l’adéquation selon Spinoza, fondée sur la puissance. Il s’agit d’un renversement total de nos perceptions et de nos pratiques et pas seulement d’un ralentissement ou d’une simple réorientation. Félix Guattari avait proposé en 1989 le concept d’écosophie, l’écologie environnementale ne pouvant se dissocier de deux autres écologies, sociale et mentale.
- Énergies ultravertes ?
Pour conclure sur une note optimiste et concrète tout en soulignant que l’empreinte spatiale concerne aussi les océans.
Des océans sains jouent un rôle majeur dans la régulation du climat par leur fonction de pompe à carbone et de producteur d’oxygène grâce au plancton. Ils contribuent à l’économie locale, nationale et mondiale avec plus de 350 millions d’emplois dans le monde, à travers l’aquaculture ou les biotechnologies.
Mais les écosystèmes marins sont menacés par la désoxygénation. La surface des milieux pauvres en oxygène a quadruplé en cinquante ans. Les effets combinés de la surcharge en nutriments et du changement climatique augmentent le nombre et la taille de ces « zones mortes » en haute mer et en eaux côtières. Dans ces zones, beaucoup d’organismes meurent asphyxiés tandis que d’autres espèces peuvent y prospérer mais au détriment de la biodiversité (proliférations algales).
Des plateformes d’éoliennes offshore pourraient apporter une solution. Pas seulement une solution énergétique (de l’hydrogène vert) par électrolyse de l’eau. L’électrolyse permet de séparer l’hydrogène de l’oxygène, la production d’un kilo d’hydrogène générant huit kilos d’oxygène. Ce dernier peut servir à stériliser l’eau (par un processus d’ozonage) et la rendre sûre et potable, ce qui dans certains pays peut être bénéfique pour la santé publique. Il est peut-être possible que l’oxygène ainsi produit en grande quantité soit utilisé à des fins environnementales directes. Réinjecté dans les milieux marins les plus appauvris, il peut améliorer ces milieux, permettre à la faune et à la flore de renaître.
Ces procédés de géo-ingénierie doivent cependant faire l’objet d’études approfondies et déboucher sur des tests réalisés dans des espaces bien choisis et limités. Car les écosystèmes marins sont complexes, leurs évolutions sont chaotiques (au sens mathématique) et beaucoup d’espoirs ont été déçus dans ce domaine ces dernières années. De plus, la mise en œuvre à grande échelle de ces processus de mitigation, par exemple dans l’espace ouvert de la mer Baltique, ne dépend pas d’un seul pays et doit respecter les conventions internationales.
Si ces conditions préalables sont remplies, l’hydrogène permettrait la production et l’usage d’énergie sans impact sur l’environnement. Et même, ce qui serait évidemment spectaculaire car ce serait tout le contraire de la filière pétrole, avec des effets positifs puisque sa fabrication offrirait un moyen de soigner des zones maritimes en situation d’hypoxie ou d’accélérer les effets d’autres traitements. C’est pourquoi je les ai qualifiées par un néologisme, celui d’énergies ultra-vertes.
Une énergie qui protégerait l’océan, sans risques, sans emprise majeure sur le territoire ? Impossible à atteindre complètement sans doute, mais qui indique la bonne direction pour sauver le monde vivant et nourrir les hommes.
Marc Guillaume, Professeur émérite