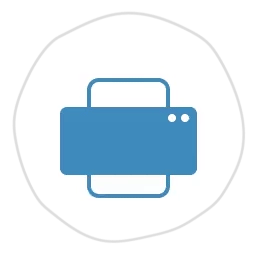Dans le secteur agricole, tout reste à entreprendre en matière de décarbonation. La question est d’initier la transition sur un plan opérationnel et de stimuler les acteurs du secteur par des outils comme la compensation volontaire ou le futur éco-régime de la PAC. Cette décarbonation doit être mesurable pour être conduite en toute transparence par rapport aux fonds investis dans les projets. Le label bas carbone (LBC) est un premier garde-fou dans cette aventure.
L’objectif est d’aboutir à un équilibre entre émission et absorption des GES d’ici 2050. Pour arriver à cet équilibre, les protagonistes savent qu’ils peuvent jouer sur deux tableaux : améliorer leur capacité d’absorption (sols, forêts, biomatériaux…) ou conduire la transition vers une agriculture plus faiblement émettrice de GES.
En France, une stratégie nationale bas carbone (SNBC) a été adoptée dans le cadre de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte. Elle indique les grandes lignes de la nécessaire transition pour aboutir à la neutralité carbone :
- Décarboner à 100% hors transport aérien ;
- Diviser par deux les consommations d’énergie ;
- Réduire les émissions non énergétiques ;
- Augmenter et sécuriser les puits de carbone.
La responsabilité agricole
Protoxyde d’azote, méthane et dioxyde de carbone sont des gaz à effet de serre aux impacts variables. Les deux premiers sont particulièrement actifs du fait de leur pouvoir réchauffant, respectivement 298 et 25 fois plus que le dernier. Ils représentent environ 50% des émissions agricoles. Finalement, l’activité agricole représente 20% des émissions de GES.
Pour ces gaz polluants, des sources sont identifiées : engrais, urée, déjections et fumier pour le protoxyde d’azote ou dégradation des micro-organismes pour le méthane.
En contrepartie, un mécanisme naturel de stockage entre en action : la biomasse aérienne utilise le dioxyde de carbone pour sa synthèse et le piège dans ses tiges, ses feuilles et ses racines. Il finit par se décomposer lentement dans les sols qui représentent de véritables puits de carbone.
Mais l’exploitation ultérieure de ces sols vient modifier les capacités de stockage, à la hausse ou à la baisse, selon les usages.
L’institut national de la recherche agronomique et de l’environnement (INRAE) a d’ores et déjà identifié des pistes d’amélioration des techniques agricoles :
- Optimiser l’usage entre les engrais de synthèse et les fertilisants organiques ;
- Privilégier les légumineuses pour un double bénéfice, leur forte capacité d’absorption de l’azote et l’économie d’apport azoté sur la culture ;
- Espacez le labour, en conservant le travail du sol en continu ;
- Favoriser les cultures intermédiaires ou intercalaires ;
- Développer l’agroforesterie et les haies ;
- Optimiser la gestion des prairies par un pâturage et une durée de vie allongés ;
- Réviser le régime alimentaire des bovins pour réduire la production de méthane : intégration de graines d’oléagineux, ajout d’additif dans les rations pauvres en azote fermentescible ;
- Réduire la part des protéines non fixées par les vaches et ajuster la ration des porcs en fonction de leur âge ;
- Capter le méthane par des torchères ou de la méthanisation ;
- Engager une réduction de la consommation de gaz, fioul ou gazole pour l’exploitation.
L’INRAE évalue les surcoûts de certaines actions au-delà de 25€ la tonne de dioxyde de carbone évitée. Ce sont notamment les investissements sans retour direct, les achats d’intrants spécifiques ou le temps passé sur les cultures intermédiaires. Par contre, la méthanisation, la réduction du labour, l’agroforesterie ou le développement de légumineuses permettent des économies qui compensent un peu.
L’action publique et industrielle
Depuis 2005, le protocole de Kyoto permet aux États de compenser leurs émissions en s’investissant dans la réduction des émissions de GES.
Les entreprises et les collectivités sont aussi autorisées à compenser pour le compte de tiers en achetant 1 « crédit carbone » pour financer un projet de traitement d’1 tonne de carbone. En général, les entreprises commencent d’abord par réduire leurs propres émissions dans leur périmètre d’activité, ensuite, elles poursuivent l’effort à l’extérieur en achetant les crédits carbone.
Pour garantir la pertinence de l’investissement, l’État a récemment instauré un Label Bas Carbone (LBC) pour caractériser le projet. Ce label garantit la contribution de celui-ci à une réduction ou à une séquestration de carbone quantifiable.

En septembre 2019, l’Institut de l’élevage (IDELE) a obtenu ce label pour sa méthodologie Carbon Agri, adaptée aux bovins. 22 porteurs de projets ont déployé la méthode auprès de 391 éleveurs. Collectivement, ils se sont engagés à économiser 70 000 tonnes de carbone, valorisées 30 € la tonne pour des gains nets attendus entre 5 000 € et 20 000 € par exploitation.
En parallèle, en avril 2021 devrait aboutir la nouvelle réforme de la PAC et la mise en place d’un dispositif qui va se substituer au « paiement vert » : l’éco-régime. Celui-ci, partie intégrante du programme stratégique national (PSN), se verra gratifié de 20% des allocations.
Cet éco-régime vise à promouvoir les pratiques durables et notamment la réduction ou séquestration de carbone, au-delà de la simple compensation financière. Les projets labellisés « bas carbone » sont donc des actions éligibles à ce dispositif.
Mesurer la décarbonation
Les institutions techniques comme Arvalis, l’ITB et Terres Inovia planchent sur des méthodes de diagnostic pour exprimer en tonnes ou en euros le bilan carbone des parcelles. Une reconnaissance de la méthode par le ministère de la Transition écologique est attendue début 2021.
Avec les prairies temporaires, les grandes cultures représentent la majorité du potentiel de stockage additionnel du carbone, contrairement aux forêts où aucune nouvelle pratique plus stockante n’a été identifiée (Etude INRAE Juillet 2019). La forêt française couvre 30% du territoire. Si sa qualité de puits à carbone est confirmée, sa surface n’évolue pas et son potentiel additionnel est limité. Par contre, à la frontière entre la forêt et les cultures, les haies ou l’agroforesterie sont des réserves potentielles.
Une fois Le label bas carbone obtenu (LBC) par ces instituts, l’outil de diagnostic permettra de faire certifier des exploitations quant au carbone séquestré ou réduit dans ses émissions. La tonne de carbone pourra alors être rémunérée dans le cadre de la compensation volontaire.
Le label engage prioritairement les candidats à réduire les émissions de GES avant de miser sur des capacités de stockage potentiellement altérables.
Les engrais azotés jouent un rôle central dans l’émission de GES, à tous les niveaux, de leur fabrication à leur distribution et utilisation. Un usage intelligent de ces engrais par des outils de pilotage est un prérequis préalable aux substituants.
Tous s’accordent sur les répercussions économiques des transitions agricoles à mener pour la réduction : 13 €/ha/an pour le semis direct, 118 €/ha/an pour l’agroforesterie ; 39 €/ha/an pour l’extension des cultures intermédiaires. A contrario, le recours aux matières organiques représente un bénéfice de 52 €/ha/an.
La perception de crédits carbones peut venir compenser ces coûts.
Soil Capital, par exemple, propose un minimum de 27,5 € ha/an la tonne de carbone stockée ou économisée avec un potentiel annuel de 1 et 3 t/ha. Saipol propose jusqu’à 40 € pour une tonne de colza ou de tournesol propre à un usage biocarburant.
 Au-delà de la décarbonation
Au-delà de la décarbonation
La décarbonation n’est pas qu’un projet dont il faut démontrer la rentabilité. C’est une nouvelle voie alternative à celle que nous connaissons aujourd’hui et qui présente ses limites. éawLes incitations financières visent à pousser les acteurs à engager une transition vers plus de biodiversités avec une approche plus globale et moins « parcellaire » de l’agriculture.
Dans les cultures, les prairies ou les vignobles, il est démontré que la présence d’arbres a des effets sur la qualité biologique des sols, la réaction aux parasites, la ressource en eau, l’environnement climatique, la valorisation paysagère, sans oublier les sous-produits (bois, fruits). Tous ces bénéfices s’ajoutent à la capacité de stockage du carbone.
Mais, cette écologie fonctionnelle se traduit par un partage des espaces entre l’agriculteur, la forêt et la faune, une forme d’exploitation en copropriété. Les bénéfices quantitatifs, agronomiques et environnementaux sont plus aléatoires pour l’agriculteur qui peut voir ses objectifs contrariés. D’où la nécessité de mieux comprendre le potentiel des interactions par des études scientifiques traduites en termes opérationnels pour les acteurs du terrain.
Le retour de cette nouvelle cohabitation impose aussi de sécuriser juridiquement les relations entre propriétaires d’espaces et fermiers et de revoir les modes de valorisation foncière des exploitations si elles ne sont plus cultivées à 100%.
La décarbonation va engendrer des actions bénéfiques sur la fertilité des sols sous l’effet du relèvement du taux de matière organique, sur la qualité de l’eau ou de la biodiversité.
Pour les autres secteurs, sa mise en œuvre va induire de l’activité dans la construction, la rénovation ou les nouveaux services. Selon une étude de l’Ademe, réalisée à l’occasion de la publication du rapport annuel 2020 du Haut Conseil pour le climat, 600 000 emplois seraient créés à l’horizon 2030, notamment dans le bâtiment, les transports et l’industrie. WWF table même sur 2 millions d’emplois pour le « verdissement » de nos activités.
Il faudra peut-être même conduire cette décarbonation sans la fameuse croissance verte, un mythe selon certains. Le 11 janvier dernier, l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a publié son rapport « Croissance sans croissance économique », dans lequel elle rappelle l’urgence face à la perte de capital naturel, le lien entre cette perte et la croissance sauvage et la possibilité d’une décroissance ou post-croissance.
Source : Plein Champ, Le Monde