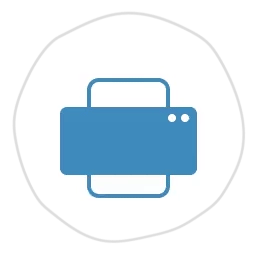Cmnews
Début 2018, la branche Afrique du Groupe Rougier annonce son dépôt de bilan. C’est un choc pour la profession forestière tropicale et les observateurs de l’industrie du bois en Afrique. Entreprise familiale cotée en bourse, la société Rougier fondée en 1923 à Niort, est une des plus anciennes et des plus importantes sociétés exploitant du bois en Afrique. Ses premières exploitations d’okoumé ayant commencé dans les années 1950 au Gabon, elle est également présente au Cameroun, au Congo et, depuis 2015, en Centrafrique (RCA). La surface totale détenue en concession par le groupe Rougier s’élève à plus de 2,3 millions d’hectares et il emploie 3000 salariés, essentiellement en Afrique. Il devrait se désengager totalement ou partiellement de ses activités d’exploitation, sauf au Gabon.
Les raisons indiquées par la direction du Groupe pour ce dépôt de bilan renvoient à des problèmes connus et qui sont communs à l’ensemble de la filière exportatrice. À l’engorgement du port de Douala d’où partent les produits bois de la plupart des entreprises du Cameroun (mais aussi du Congo et de la RCA) après un long acheminement en train ou en camion, s’ajoutent les retards croissants de remboursement de la TVA aux exportateurs par les Etats d’Afrique centrale. Ces problèmes affectent également d’autres sociétés forestières, européennes pour la plupart, qui ont dû céder une partie de leurs actifs ces derniers mois. Le Groupe Wijma Cameroun, à capitaux hollandais, a dû céder en 2017 à une entreprise concurrente (Vicwood SA, dont le siège est à Hong-Kong) quatre de ses cinq concessions forestières au Cameroun. La société italienne Cora Wood SA, fabricant réputé de contreplaqué établi au Gabon, a dû céder une de ses concessions à une société chinoise pour éponger ses dettes. Les rumeurs courent à propos de possibles cessions prochaines d’autres sociétés européennes, au Gabon ou au Congo.
La fin d’un cycle
Même si les cessions d’entreprises forestières européennes à des sociétés asiatiques ont commencé au début des années 2000, il est probable que les difficultés actuelles de Rougier marquent un tournant. Au-delà des problèmes conjoncturels, on sent venir la fin d’un cycle économique assez vertueux. Celui-ci a été ouvert par les premiers plans d’aménagement forestiers dans les années 1990, et s’est prolongé par l’essor de la certification de « bonne gestion forestière » (le label Forest Stewardship Council, FSC) une quinzaine d’années plus tard. On avait alors pensé qu’une exploitation forestière durable de la forêt naturelle, conciliant profitabilité économique, dimension écologique et progrès social, avait démontré sa faisabilité en Afrique centrale, malgré les problèmes notoires de gouvernance dans cette région. Cependant, la profitabilité de l’exploitation des forêts naturelles repose, jusqu’à maintenant, sur le prélèvement d’une poignée d’espèces bien connues des consommateurs de bois. Au Gabon, c’est l’okoumé ; au Cameroun, l’ayous, le sapelli et l’azobé ; au Congo, le sapelli au Nord et l’okoumé au Sud ; en RCA, le sapelli ; et en RDC, ce sont quelques essences précieuses comme le wengé ou l’afrormosia qui permettent de rentabiliser les opérations. L’avantage de cette exploitation extrêmement sélective est que la forêt n’est guère endommagée par des prélèvements qui dépassent rarement, en moyenne, un ou deux arbres par hectare, soit10 à 12 m3. Le revers de la médaille est que la concentration des récoltes sur cette poignée d’essences conduit progressivement à un épuisement du « gisement » au fur et à mesure que les forêts sont mises en exploitation de manière systématique. Cet épuisement ne signifie pas, en principe, que ces espèces deviennent menacées de disparition. Le problème est plutôt économique : les volumes restant au deuxième passage d’exploitation (légalement, 25 à 30 ans entre deux passages) ne suffisent généralement plus pour soutenir une activité industrielle et répondre à la demande des marchés. Le cas de la société Rougier est emblématique à cet égard : son rachat, en 2015, d’une concession en RCA répondait à la volonté d’approvisionner la principale usine du groupe au Cameroun, peu éloignée de la frontière centrafricaine. C’était une conséquence directe de la baisse des volumes disponibles de sapelli et d’ayous dans l’Est du Cameroun, région exploitée de manière répétée (par les industriels mais aussi par les exploitants artisanaux) depuis plusieurs décennies. Au Cameroun, l’abandon de plusieurs concessions par la société Wijma est également liée à la forte baisse du volume d’azobé à la fin du premier passage en exploitation de ces permis.

Cirad
S’il reste encore de nombreux sapelli dans les concessions du nord Congo ou d’okoumé dans celles du Gabon, les opérateurs pressentent qu’ils arrivent à la fin d’un cycle, et que la « rente de forêt primaire », ce volume exceptionnel obtenu lors des premiers passages en coupe dans les forêts anciennes, achève progressivement de se dissiper. Certes, il y a de nombreuses autres espèces exploitées ou potentiellement exploitables dans ces forêts. Mais, soit elles ne sont pas suffisamment abondantes pour remplacer les essences traditionnelles, soit leur prix de vente est insuffisant au regard des coûts d’exploitation, de transport, et éventuellement de transformation. Les marchés sont assez conservateurs, et les ordres d’achat tendent à se concentrer sur les essences les plus connues. Si, sur la dernière décennie, les acheteurs ont commencé à s’intéresser plus sérieusement à des essences comme l’okan ou le tali, dont les prix ont ainsi connu des augmentations spectaculaires, ces exemples restent rares et ces deux espèces ne sont pas suffisamment abondantes pour acquérir la même importance économique que le sapelli ou l’okoumé.
La plantation d’espèces de bois d’œuvre constituerait la réponse logique à cet épuisement des « gisements » traditionnels en forêt naturelle. Mais on sait que, sans puissantes incitations économiques ou directives autoritaires d’une administration clairvoyante, les opérateurs économiques n’investiront pas dans de coûteuses plantations qui n’entreront en production que dans trois décennies. En outre, la sylviculture des essences les plus intéressantes économiquement n’est pas toujours bien maîtrisée. Et la qualité n’est pas toujours au rendez-vous : les okoumés plantés, par exemple, n’offrent pas la même qualité de bois que les okoumés sauvages. Reste enfin la question des droits de propriété : qui possèdera, dans une trentaine d’années, les droits sur des arbres plantés au sein des concessions par des opérateurs qui ne seront sans doute plus en activité ?
Une compétition faussée ?
Les concessionnaires européens, jadis incontournables dans l’exploitation et l’industrie du bois africain cèdent peu à peu leurs actifs aux investisseurs asiatiques. Si les opérateurs malaisiens sont présents en Afrique centrale depuis le milieu des années 1990[1], des entreprises chinoises sont entrées en force dans la filière depuis les années 2000, et, plus récemment, ce sont des investisseurs indiens, dont la multinationale Olam, qui se sont fait remarquer au Gabon et au Congo. Ces exploitants disposent de capitaux importants et les marchés sur lesquels ils opèrent acceptent des qualités parfois inférieures à celles que demandent les acheteurs européens. Ceci leur permet d’exploiter une gamme plus large d’espèces – même si la composition spécifique de leurs récoltes n’est pas, en fin de compte, très différente de celle de leurs homologues européens.
 La montée en puissance de ces opérateurs asiatiques dans l’industrie forestière fait écho, bien sûr, à celle que l’on observe dans les autres secteurs économiques en Afrique. Elle correspond aussi à l’évolution des flux commerciaux, avec des exportations de bois africain qui se destinent de moins en moins à l’Europe et de plus en plus à l’Asie. La Chine vient en tête, mais l’Inde et le Vietnam accroissent rapidement leurs achats. Les opérateurs européens se demandent s’ils jouent bien à armes égales avec certains de leurs compétiteurs asiatiques. Les grandes entreprises européennes se sont progressivement conformées aux normes légales en préparant des plans d’aménagement forestiers, rendus obligatoires par les nouvelles générations de lois forestières apparues dans les années 1990-2000. Une partie d’entre elles est allée plus loin, en adoptant une certification forestière exigeante, le FSC. Ce label est important pour gagner ou conserver des parts de marché sur certains marchés occidentaux sensibles aux questions environnementales (en Europe du Nord, notamment) et espérer un prix d’achat plus élevé pour les bois ainsi labellisés. La certification constitue donc un investissement, qui pousse les entreprises à s’autoréguler pour ne pas perdre le label dont la mise en œuvre sur le terrain est vérifiée régulièrement par des auditeurs indépendants. Or, mis à part la société Olam qui a racheté en 2011 à une société danoise une grande concession déjà certifiée au nord Congo, aucun opérateur à capitaux asiatiques n’a cherché sérieusement, au moins jusqu’à présent, à obtenir le label FSC pour ses permis. Et nombre d’entre eux n’ont pas préparé ou ne mettent pas en œuvre de plan d’aménagement. Des entreprises asiatiques sont souvent épinglées par les observateurs pour des activités illicites. Ces derniers mois au Gabon l’exploitation et l’exportation illégale du kévazingo, une essence de haute valeur commerciale, a défrayé la chronique. Les sanctions prises par les administrations à l’encontre de ces pratiques illicites, sans être inexistantes, ne sont guère dissuasives : il est rare qu’un contrat de concession soit annulé ou que de très fortes amendes soient prononcées. L’exportation des bois en container, y compris, aujourd’hui, les grumes, inspectés de manière aléatoire facilite les trafics. L’application des lois est, à l’évidence, défaillante, et ceci est en partie à l’origine des différences de profitabilité entre nombre d’entreprises asiatiques et la plupart des entreprises européennes. Si les bois certifiés sont vendus plus cher sur certains marchés sensibles, une bonne partie des bois labellisés s’écoule à prix courant sur les marchés du Sud et de l’Est de l’Europe, du Moyen-Orient ou de l’Asie. Et dans ce cas, l’investissement dans la certification n’est pas rentable.
La montée en puissance de ces opérateurs asiatiques dans l’industrie forestière fait écho, bien sûr, à celle que l’on observe dans les autres secteurs économiques en Afrique. Elle correspond aussi à l’évolution des flux commerciaux, avec des exportations de bois africain qui se destinent de moins en moins à l’Europe et de plus en plus à l’Asie. La Chine vient en tête, mais l’Inde et le Vietnam accroissent rapidement leurs achats. Les opérateurs européens se demandent s’ils jouent bien à armes égales avec certains de leurs compétiteurs asiatiques. Les grandes entreprises européennes se sont progressivement conformées aux normes légales en préparant des plans d’aménagement forestiers, rendus obligatoires par les nouvelles générations de lois forestières apparues dans les années 1990-2000. Une partie d’entre elles est allée plus loin, en adoptant une certification forestière exigeante, le FSC. Ce label est important pour gagner ou conserver des parts de marché sur certains marchés occidentaux sensibles aux questions environnementales (en Europe du Nord, notamment) et espérer un prix d’achat plus élevé pour les bois ainsi labellisés. La certification constitue donc un investissement, qui pousse les entreprises à s’autoréguler pour ne pas perdre le label dont la mise en œuvre sur le terrain est vérifiée régulièrement par des auditeurs indépendants. Or, mis à part la société Olam qui a racheté en 2011 à une société danoise une grande concession déjà certifiée au nord Congo, aucun opérateur à capitaux asiatiques n’a cherché sérieusement, au moins jusqu’à présent, à obtenir le label FSC pour ses permis. Et nombre d’entre eux n’ont pas préparé ou ne mettent pas en œuvre de plan d’aménagement. Des entreprises asiatiques sont souvent épinglées par les observateurs pour des activités illicites. Ces derniers mois au Gabon l’exploitation et l’exportation illégale du kévazingo, une essence de haute valeur commerciale, a défrayé la chronique. Les sanctions prises par les administrations à l’encontre de ces pratiques illicites, sans être inexistantes, ne sont guère dissuasives : il est rare qu’un contrat de concession soit annulé ou que de très fortes amendes soient prononcées. L’exportation des bois en container, y compris, aujourd’hui, les grumes, inspectés de manière aléatoire facilite les trafics. L’application des lois est, à l’évidence, défaillante, et ceci est en partie à l’origine des différences de profitabilité entre nombre d’entreprises asiatiques et la plupart des entreprises européennes. Si les bois certifiés sont vendus plus cher sur certains marchés sensibles, une bonne partie des bois labellisés s’écoule à prix courant sur les marchés du Sud et de l’Est de l’Europe, du Moyen-Orient ou de l’Asie. Et dans ce cas, l’investissement dans la certification n’est pas rentable.
Des investissements insuffisants pour l’innovation
Si l’on peut estimer que la « mauvaise gouvernance » fausse la compétition entre les entreprises certifiées et les autres, les opérateurs « historiques » payent aussi des investissements insuffisants dans l’innovation technique et le marketing. Contrairement à une idée reçue, la majorité du bois africain aujourd’hui exportée est transformée localement. Si certaines entreprises, notamment italiennes, ont su se différencier en proposant des produits sophistiqués et attractifs, la plupart des transformateurs restent concentrés sur des « commodités », c’est-à-dire des sciages de taille standard, des bois déroulés pour les placages ou du contreplaqué. Vendre des commodités, c’est se condamner à rester « price taker », à dépendre des cours internationaux des bois et des préférences changeantes des acheteurs. Et ces derniers se tournent volontiers vers les bois asiatiques, voire les bois tempérés ou boréaux, quand les prix des bois africains grimpent exagérément à leurs yeux.
Fabriquer des produits finis, valoriser intelligemment les sous-produits du bois, trouver des utilisations appropriées aux espèces abondantes, mais faiblement rémunératrices (en les plaçant, par exemple, au cœur des contreplaqués, comme les industriels d’Asie le font avec du bois de peuplier enserré dans des feuilles de placage d’essences « nobles ») constituent des voies possibles pour retrouver la valeur ajoutée qui tend à se dissiper avec la raréfaction des essences traditionnelles qui ont permis l’essor de l’industrie africaine du bois. Optimiser la chaîne de valeur, cela peut signifier également valoriser les déchets de bois à travers des processus de cogénération, dès lors que le contexte s’y prête et que la production de bois mensuelle est suffisamment élevée pour rentabiliser l’opération. S’il ne faut pas sous-estimer les difficultés de telles évolutions dans des pays où les infrastructures sont défaillantes, où le personnel qualifié manque cruellement à l’appel et où les surcoûts sont légion, il reste que certaines des entreprises européennes aujourd’hui en difficulté n’ont sans doute pas su investir de manière avisée les bénéfices confortables qu’elles ont réalisés lors de périodes plus fastes.
L’industrie du bois africain est condamnée à une telle « sortie par le haut » du fait notamment des débouchés restreints des marchés domestiques. Les coûts de production du bois industriel n’ont cessé de croitre depuis deux décennies, du fait des normes d’aménagement, de la fiscalité ou du coût des différents cahiers des charges mis en place par les pouvoirs publics. D’un autre côté, le pouvoir d’achat des consommateurs africains ne progresse guère, voire s’effrite. Si, dans les années 1980, les transformateurs industriels du bois au Cameroun écoulaient entre un quart et un tiers de leur production sur le marché intérieur, cette proportion est devenue presque insignifiante une vingtaine d’années plus tard. C’est le « secteur informel », composé de scieurs artisanaux opérant généralement dans l’illégalité, qui fournit les marchés domestiques en croissance des pays africains. En RD Congo, ces artisanaux mobilisent nettement plus de bois que l’industrie formelle. Quant aux marchés sous-régionaux africains, ils sont en croissance continue mais ne sont guère rémunérateurs, car, là aussi, la concurrence des bois artisanaux, objet de trafics frontaliers intenses (par exemple entre le Cameroun et le Tchad), tire les prix vers le bas.